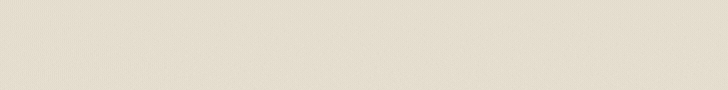La médecine vétérinaire connaît, depuis plusieurs décennies, une mutation profonde de sa démographie. Hier encore dominée par des hommes, la profession est aujourd’hui largement féminisée, aussi bien dans les écoles que dans les cabinets. Cette transformation, souvent citée mais peu analysée en profondeur, soulève de nombreux enjeux pour le métier, son organisation et son avenir.
Une évolution massive : quelques chiffres clés
En 1980, moins de 30 % des vétérinaires inscrits à l’Ordre étaient des femmes.
En 2024, près de 70 % des vétérinaires en activité sont désormais des femmes.
Et dans les écoles vétérinaires françaises, plus de 85 % des étudiants sont aujourd’hui des étudiantes.
Ce basculement est rapide, durable, et non spécifique à la France. Il s’observe dans l’ensemble des pays européens, et plus généralement dans les filières médicales et paramédicales. Il reflète à la fois l’évolution de l’accès aux études supérieures pour les femmes et l’attractivité du métier pour des profils historiquement minoritaires.
Des impacts sur la pratique… et sur l’organisation
La féminisation du métier induit plusieurs évolutions notables dans les modes d’exercice :
-
Une recherche accrue d’équilibre vie pro / vie perso, souvent incompatible avec le modèle classique d’installation en solo.
-
Une baisse du taux d’installation à son compte, notamment chez les jeunes praticiennes.
-
Une montée en puissance des formes d’exercice collectif : cliniques de groupe, salariat, SCM.
-
Une attention renforcée aux conditions de travail, au management collaboratif, à l’éthique et à la prévention des risques psycho-sociaux.
Ces tendances impactent directement l’organisation des structures, les politiques RH, et les modèles économiques des cliniques vétérinaires.
Une tension persistante sur les postes à responsabilité
Malgré la majorité féminine parmi les vétérinaires en exercice, les postes à responsabilité restent encore majoritairement masculins.
Selon les données de l’Ordre, les femmes vétérinaires :
-
sont moins nombreuses à diriger des structures,
-
moins représentées dans les instances nationales et locales,
-
moins présentes dans les fonctions de représentation ou d’enseignement supérieur.
Cette sous-représentation pose question et soulève la nécessité de mieux accompagner l’accès des femmes aux responsabilités dans la profession, à travers des politiques plus inclusives et des modèles de carrière adaptés.
Un moteur d’évolution pour la profession
La féminisation ne signe pas la fin d’un modèle, mais bien l’évolution d’une profession vers plus de diversité, de flexibilité et de réflexion collective. Elle pousse le secteur vétérinaire à :
-
s’interroger sur ses codes traditionnels,
-
inventer de nouveaux formats de travail (temps partiel, téléconsultation, co-gérance),
-
repenser l’attractivité du métier et la qualité de vie au travail.
Dans un contexte de pénurie de praticiens et d’épuisement professionnel croissant, ces mutations sont une opportunité à saisir collectivement.
La féminisation de la médecine vétérinaire est un fait structurel : elle transforme les visages de la profession, mais aussi ses pratiques, ses attentes et ses équilibres internes. Pour rester durable et attractive, la filière vétérinaire doit désormais intégrer cette réalité à tous les niveaux : formation, exercice, gouvernance, transmission.













 Offres d’emplois
Offres d’emplois